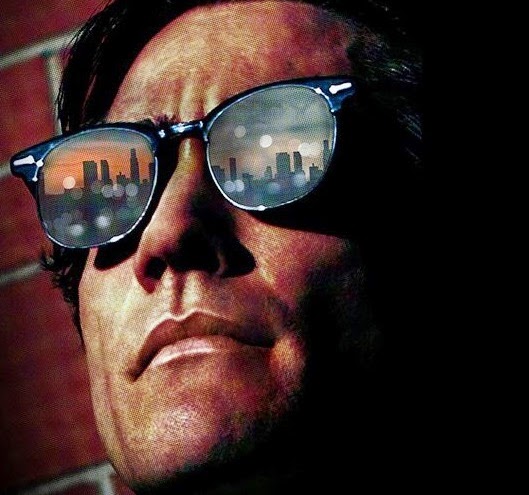À son époque, Texas Chainsaw Massacre fut un interdit, un pavé dans la mare, une révolution. Un objet fédéré, qu'on se passait presque sous le manteau (malgré un passage remarqué à Avoriaz), qui quittait petit à petit son statut de légende urbaine pour atteindre celui de classique. Tout comme La nuit des morts-vivants puis Evil Dead en leur temps, ce qui n'aurait pu être qu'une simple série b deviendra une leçon de cinéma et un modèle pour tous les bricolos un peu tarés du cinéma.
![]()
1974 – 2014 : aujourd'hui, le film fête ses quarante ans, revenant dans une copie flambant neuve qui fit hésiter les puristes ("pourquou vouloir nettoyer un film si crasseux ? ") avant de s'imposer en redécouverte indispensable. Un bien beau cadeau à une œuvre beaucoup moins hasardeuse que ses congénères de l'époque, et fignolée avec une incroyable maestria, que Hooper abandonnera dans la suite, inégale, de sa carrière. Les nombreux – et superbes – travellings, les contre-plongées, les tableaux de désolations à la fois étouffants et sublimes (ciel bleu dévorant, nuit sans fond, aube dorée). Rarement dans le cinéma d'horreur, la texture des décors avait semblé aussi palpable, avec ces herbes brûlées par le soleil, ces murs qui s'effritent, ces charognes pendues ou ce générateur électrique annonçant la célèbre tronçonneuse.
Bruit de cercueils cassés dans l'obscurité, os séchés, viande ruisselante, cadavres encore agités de spasmes : une proximité macabre inédite en son temps, radicale et sans détour. Le générique, sur fond de marques solaires rougeoyantes et de faits divers sordides, donne le ton : l'Amérique est un triste monde tragique.
![]()
![]()
![]()
Cauchemar du flower-power, conte de fées putride (ces bois en pattes d'araignées, digne de la forêt de Blanche Neige de Disney), faux slasher (le film évoque déjà l'iconisation du masque de terreur et de l'arme toute-puissante, le sacre de la final girl...), cartographie sans pitié des States : les milles et une facette de Massacre à la tronçonneuse fascinent encore et toujours. Sa manière de suggérer la violence fera peu d'émules (les suites dévoileront, en terme graphique, tout ce que Hooper avait tenté de nous cacher), mais ces dégénérés feront indéniablement des petits, bien que Délivrance et 2000 Maniaquesavaient déjà tâté du terrain côté rednecks. Hooper laisse l'imagination courir, avant que les séquelles ne révèlent le pot aux roses.
Mais à contrario d'un Psychose plus feutré, la réutilisation du mythe d'Ed Gein se fait ici dans la plus totale crudité, avec ce mobilier humain nous faisant écarquiller les yeux aux quatre coins de l'écran. L'humain, recyclé comme au temps de l'Holocauste, devient masque, lampe, chaise, gri-gri, nourriture sans doute (le cannibalisme n'est encore que sous-entendu dans cet opus) : l'homme est relégué à son statut de barbaque et d'animal à découper.
![]()
L'humour noir distillé à petites gouttes (Franklin l'handicapé, semble être le souffre douleur du film, et Leatherface, boucher de l'enfer, est un poupon travesti compensant sans doute avec sa lame, idée que sa suite exploitera avec jubilation), les cris inondant de plus en plus la bande-son, l'art de filer droit comme un train qui hurle : Hooper a un sens du crescendo remarquable, qui éclate dans un climat d'hystérie collective donnant l'impression de s'engouffrer dans un asile grand ouvert. À bout de souffle, les dernières minutes restent un sommet d'horreur crépusculaire, avec cette danse vrombissante sur fond de soleil levant, qu'un cut définitif achèvera dans les mémoires. Un chant de mort indémodable.
LE BONUS : INFLUENCES À LA TRONÇONNEUSE
![]()
* Night of fear (1972) Terry Burke : On pourrait vous parler de Wake in fright, autre grand film australien sur l'enfer rural, mais ce Night of Fear, aussi obscur que inédit de partout, a davantage d’accointances avec le film de Hooper. À l’origine, celui-ci était le pilote d'une série tv baptisée Fright (façon Tales from the crypt and co) qui ne verra hélas jamais le jour : il faut dire que ce premier (et dernier) essai avait frappé fort et s'est vu condamné fissa par la censure. Trop fou, trop bizarre, autant pour le cinéma que pour la télé, cet ovni complètement dégénéré finira abandonné. Plutôt triste lorsque l'on découvre ces 50 minutes haletantes, sans aucun dialogue, où une jolie blonde se plante en voiture et finit poursuivie par un fermier ravagé du ciboulot. L'atmosphère déliquescente (sexuellement plus dérangeante encore) qui fera le bonheur de Hooper est déjà là en filigrane, le tout d'une cruauté et d'une inventivité (le montage, complètement fou, évoque un cauchemar éveillé) constante.
![]()
* L'abattoir humain (1973) William Girdler : On a connu ce brave artisan de Girdler bien plus en forme à l'avenir (Grizzly, Day of the Animals...) avec ce petit film grindhouse à l’intérêt quasi-documentaire. Car inutile de le cacher : Three on a Meathook (de son vrai nom) est vraiment très très mauvais ! Excessivement bavard, mou, ringard, même pas drôle : on est pourtant en présence d'un des rares pré-slasher complètement oublié de cette époque (comme le british The Haunted house of horror) : ainsi, quatre copines se paument dans la cambrousse et se font alors dézinguées une par une (les quelques meurtres gores sont d'ailleurs ce qu'il y a de plus réussi) par leurs hôtes, des paysans du cru pas si accueillant. Des dérives annonçant clairement l'atmosphère rurale de TCM (fermiers louches et boucherie pas très catholique). Du massacre donc, mais sans tronçonneuse.
![]()
* Deranged (1974) Alan Ormsby & Jeff Gillen : Si TCM se contentait de reprendre des éléments de l'affaire Ed Gein, ce Deranged, d'ailleurs longtemps resté dans l'ombre, en est une retranscription plus officielle, bien que les noms furent changés. Il faudra In the light of the moon en 2000 pour un biopic plus détaillé du célèbre collectionneur nécrophile : mais il faut avouer qu'en attendant, cette variation trash de Psychose faisait tout aussi bien l'affaire. Se retrouvant seul à la mort de sa mère, Erza Cobb (incarné par l'impayable Roberts Blossom, dont le physique de "jeune vieillard" ne passe pas inaperçu) se met en tête de reconstruire le corps abîmé de sa génitrice, qu'il est allé bien sûr repêcher au cimetière du coin. Fatalement, les cadavres des tombes voisines ne suffiront plus et des victimes, vivantes elles, suivront. Très porté sur l'humour noir et le grotesque (pas toujours volontaire, comme ce présentateur moustachu interrompant sans cesse l'action !), Deranged frappe fort par son atmosphère lugubre, volontiers plus bizarre et gerbante que celle du film de Hooper : à tel point qu'on en viendrait presque à sentir les effluves des cadavres en décomposition. Réalisé la même année, hanté par la même imagerie "edgeiniene" (on assiste même à une scène de repas similaire), on ne saurait dire si l'un des deux aurait inspiré l'autre. Restons-en à l'heureux hasard....
![]()
* La colline a des yeux (1977) Wes Craven : Si La dernière maison sur la gauche (au même titre que TCM) avait eu un impact non négligeable malgré son amateurisme, on ne peut pas en dire autant de La colline a des yeux, qui ressasse une vague légende de famille sauvage, pour mieux se démarquer du film de Hooper avec un clash tragique entre deux clans, l'un civilisé, l'autre primitif et cannibale, dans le désert californien. Hormis la découverte de la tronche hallucinante en pain de sucre de Michael Berryman, il faut avouer que ce petit classique traverse bien mal le temps : risible, ramassé et vieillot, autant dire que le remake d'Aja s'imposait sans soucis. Ce qu'il en reste ? Les miettes thématiques de La dernière maison... (la barbarie derrière l'homme civilisé). Sa suite, réalisée en 1985, fera encore pire.
![]()
* Le crocodile de la mort (1978) Tobe Hooper : Réponse plus qu'évidente au succès de son œuvre phare, ce Eaten Alive ne connaîtra pas les mêmes honneurs, même s'il rejoignit également la fameuse collection de Rene Château des "films que vous ne verrez jamais à la télévision". Après Ed Gein, c'est Joe Ball (un paysan texan psychopathe qui jetait ses victimes en pâtures à ses crocodiles d'amour) dont s'inspire Hooper et son scénariste Kim Kinkel, ici aidés par un budget plus conséquent. Plus violent, plus grinçant mais moins percutant, ce "on prends plus ou moins les mêmes (on retrouve même Marilyn Burns en gueuleuse de service) et on recommence" ne sera pas une bonne expérience pour Hooper, qui quittera le plateau et laissera un autre quidam terminer le boulot. Il y a pourtant une vraie alchimie bizarre dans cette serie b méchante à souhait (la faux remplace d'ailleurs la tronçonneuse), en particulier dans l'utilisation les décors studios, irréalistes mais anxiogènes, comme un mauvais songe dont on n'arrive pas à sortir.
![]()
* Tourist Trap (1979) David Schmoeller : Sans aucun doute le démarquage le plus intéressant et le plus malin du film d'Hooper, qui part d'un canevas identique (des jeunes adultes paumés dans un coin aride, une station service zarbi, une maison isolée : même le tueur porte un masque le faisant ressembler à Leatherface !) pour s'aventurer ouvertement dans le cauchemar eveillé façon Quatrième Dimension, tout en modernisant le mythe du musée de cire par le le slasher (ce dont se souviendra La maison de Cire, qui lui piquera quelques idées). La scène d'introduction, qui laisse pantois, guide un perso chair à canon vers sa mort tout en accumulant les détails bizarres (comme ces apparitions dérangeantes de mannequins semblant doués de vie). Entre la musique lancinante de Donnaggio, ces faciès grimaçants surgissant dans la nuit et ce goût pour la poésie et l'hystérie, voilà un bijou tordu comme on les aime.
![]()
* Nuits de Cauchemar (1981) Kevin Connor : Imaginez un épisode de Shérif fais-moi peur avec du fermier cannibale au milieu, et vous aurez une idée que ce Motel Hell (titre original renvoyant à la devanture défectueuse du décor principal), devenu culte pour ses quelques idées branques mais hélas bien surestimé. Un couple de rednecks, frère et sœur, récupère les touristes égarés et autres auto-stoppeurs pour agrandir leur potager humain (!) et en faire des plats pas vraiment vegan. Relativement bien emballé, le résultat laisse pourtant de côté son prétexte horrifique jusqu'à son derniers tiers, beaucoup plus délirant: en témoigne l'apparition de Rory Calhoun en cochon armé d'une tronçonneuse, soit le premier jambon psychopathe de l'histoire du cinéma. C'est peu, mais c'est déjà pas mal.
![]()
* Le sadique à la tronçonneuse (1981) Juan Piquer Simon : "You don't have to go to Texas for a chainsaw massacre" scandait l'affiche ! Pourtant, il s'agit plus d'une réponse européenne à la vague du slasher qu'une resucée du film de Hooper (auquel il ne fait qu'emprunter la fameuse arme), Pieces est un bon gros film bis qui tâche, écartelé entre des relents nanardesques (vf anthologique, karaketa surgissant de nulle-part, rebondissements débiles) et une violence graphique tantôt crasse, tantôt stylisée. Il n'est évidemment plus question de suggestion ici, mais plutôt de générosité (fini le hors-champ et bonjour le charcutage), jusque dans une incroyable mise à mort au ralenti sur un matelas pneumatique, dont la cruauté n'aurait pas déplu à un certain Argento. Quant au sursaut final, hésitant entre l'effroi et la bêtise la plus totale, il résume bien l'interêt de la chose.
![]()
* Mother's Day (1981) Charles Kaufman : Pas très loin de la parodie, Mother's Day s'en tire pourtant bien mieux que certains de ses congénères : la touche Troma (c'est le frère de Lloyd Kaufman, patron de la firme, qui réalise) y est sans doute pour quelque chose. Survival champêtre à bases de bouseux consanguins, le résultat détonne surtout de par son humour noir, sa violence outrancière et des personnages féminins bien décidés à en découdre (dont la mère du titre, une matriarche maniaque clouée sur son fauteuil roulant). Un spectacle bien allumé, jusqu'au à son épilogue presque flippant. Notons par ailleurs que si son remake de 2010 est si réussi, c'est surtout qu'il n'entretient pratiquement aucun rapport avec l'objet du délit. Et tant mieux dans un sens.

























.jpg)





.jpg)